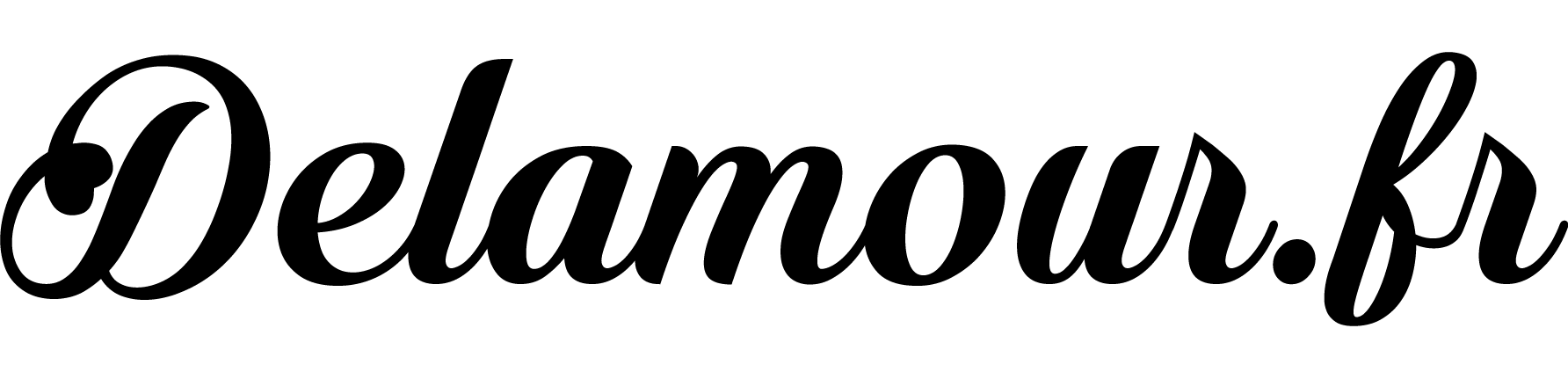La « science » du bonheur diffusée par un large courant psychologique, économique et politique, n’est-elle pas une arme politique de neutralisation massive de la critique ?
C’est l’idée centrale que l’on peut dégager du livre Happycratie et que nous proposons d’approfondir dans cet article.
La « science » du bonheur nous promet une vie heureuse sans souffrance. Dans la vie, il y a des idées et des émotions négatives et positives. Les idées et les émotions négatives sont un dysfonctionnement, le signe qu’une personne a un « problème psychologique » qu’elle doit traiter. En se concentrant sur ce qui est positif, on supprimerait ainsi automatiquement ce qui est négatif.
Mais peut-on vivre heureux sans goûter à la souffrance ?
Non. On peut avoir des sentiments ambivalents, être tout à la fois heureux et souffrir d’une peine.
Une idée/émotion négative est-elle forcément mauvaise d’un point de vue moral et politique ?
Non. Par exemple, une émotion « négative » comme la haine ou la colère est une bonne chose car elle permet de se soulever contre l’oppresseur et de lutter face à l’injustice – une pensée pour les gilets jaunes-, donc amène à une action, et une réaction politique.
La distinction entre émotion/idée négative et positive tend à cacher la question morale du bien et du mal, du juste et de l’injuste, ainsi que la question politique de l’action collective.
L’Homme, selon l’idéal néolibéral, se concentre sur ses pensées et ses émotions positives, rejette toute pensée/émotion négative, perd ainsi toute capacité de critique et de résistance, et devient ainsi à l’image d’un soldat :
« Des soldats résilients, se remettant facilement et rapidement des atrocités qu’ils sont forcés de commettre, devraient-ils être plus estimés que ceux qui en souffrent et qui en subissent les terribles compétences ? Des salariés résilients, immunisés contre les cruautés commises quotidiennement sur le lieu de travail, contre les stratégies coercitives déployées par les organisations qu’ils servent, seraient-ils plus dignes d’être admirés que ceux qui en souffrent. Il semble permis d’en douter, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan moral ». [1]
Qu’en est-il de ceux qui souffrent de ne pas pouvoir se sentir résilients ou de ceux qui ont de la culpabilité à ne pas être suffisamment heureux ? Cette forme de résilience ne nous mène-t-elle pas à un conformisme ? Sommes-nous obligés de conserver une attitude positive en toute circonstance ? Sommes-nous toujours responsables de notre souffrance ? Quelle place pour la pitié et la compassion, l’entraide et la solidarité, la justice sociale et l’action collective ? Et peut-on encore critiquer l’injustice économique et politique si l’essentiel est de s’occuper de son « développement personnel » et de ne cultiver que des idées/émotions positives en toutes circonstances ?
La culture de l’épanouissement personnel est en train de cacher et de rendre obsolète la question morale du bien et du mal et la question politique du juste et de l’injuste. Par exemple, peut-on critiquer l’Etat d’Israël lorsque celui-ci se vante d’être bien classé sur l’indice de bonheur à l’échelle internationale ? La communication autour du bien-être et du bonheur a pour but de faire oublier la situation politique de colonisation et de domination des palestiniens :
« Les Israéliens, d’ailleurs, invoquent fièrement leur très bon classement dans le palmarès mondial des pays où il fait bon vivre, comme si un tel classement pouvait occulter le fait que ce pays est affligé d’inégalités sociales plus que spectaculaires – parmi les plus fortes dans le monde – et se permet qui plus est d’en occuper un autre »[2].
De même, peut-on formuler une critique au sujet de l’exploitation des esclaves aux Emirats Arabes Unis s’il devient « the place » du bien-être et de l’épanouissement personnel ?
« Il est permis de nourrir de semblables inquiétudes, et un semblable scepticisme, lorsque des pays comme les Emirats Arabes Unis et l’Inde – caractérisés par une pauvreté endémique, par un mépris constant des Droits de l’homme et par des taux de malnutrition, de mortalité infantile et de suicide extrêmement élevés – décident d’adopter la mesure du bonheur pour ‘’mieux évaluer’’ les progrès de leurs politiques publiques »[3].
Ainsi, la critique des injustices sociales est classée comme une idée et une émotion « négative » que l’on ne doit pas exprimer. On doit plutôt se focaliser sur le « positif », sur le bonheur quelques-uns.
Le changement social a disparu de nos préoccupations : seul le changement individuel compte désormais. Or, à force d’être obsédé par le changement de soi (par la suppression des émotions et des idées « négatives », par le développement de son « potentiel »…), on a beaucoup de mal à s’impliquer dans la vie sociale, à se soucier et à prendre soin des autres. Le souci de soi a remplacé le sens de la justice et l’envie de se battre au service des autres.
Depuis cette marchandisation du bonheur et donc de nos états d’âme, de nos émotions et de nos vies, souffrir est devenu une maladie honteuse ; les problèmes collectifs économiques et politiques sont devenus des problèmes individuels psychologiques et émotionnels.
La promesse de bonheur qui nous est exprimée aboutit paradoxalement à l’obsession de son épanouissement personnel, c’est-à-dire en fait au sentiment permanent d’un mal-être, un repli sur son épanouissement personnel et un affaiblissement de son engagement au service du bien commun.
Ainsi, la psychologie positive a diffusé une vision individualiste du bonheur, vision qui renforce parfaitement l’idéal néolibéral d’un citoyen centré sur lui-même. Elle affirme que plus une nation est individualiste, plus ses citoyens sont heureux.
En ce sens, pour Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, le bonheur humain correspond à 90% [4]à des facteurs individuels et psychologiques (ainsi l’éducation, le revenu, le statut social, etc. importeraient que peu). Le danger de cette « science » du bonheur est qu’elle a tendance à encourager le retrait dans la « citadelle intérieure »[5], pour s’occuper de son bien-être et de sa « spiritualité » tout en se dégageant du champ de l’action collective. Cet individualisme égocentrique a affaibli le souci des autres, la volonté et la capacité de prendre soin les uns des autres.
Les économistes, à leur tour, vont défendre exactement la même orientation que les promoteurs de la psychologie positive. Au niveau d’une société, le bonheur a plus de valeur que la justice ou que l’égalité sociale. Car une société peut se sentir heureuse indépendamment de la juste répartition des richesses. De plus, les inégalités socio-économiques sont un bon facteur de motivation car les plus pauvres, en voyant la réussite des plus riches, sont encouragés à réussir également. Ainsi, plus les inégalités sont fortes, plus les pauvres connaissent le bonheur en s’imaginant réussir un jour. Telle est la rhétorique des économistes pour se dispenser du devoir de se battre pour plus de justice.
Pourquoi la justice ou la solidarité n’ont pas été choisies comme étant des valeurs supérieures au bonheur ? Car défendre que le bonheur est la valeur supérieure à toute autre, c’est défendre une valeur individualiste, une valeur qui pousse chacun à se concentrer sur soi plutôt que de chercher à prendre soin des autres. Car défendre que la justice et la solidarité ont plus de valeur que le bonheur individuel, c’est se voir obligé de négocier la définition et le respect du bien commun, c’est devoir appliquer plus de justice dans la redistribution des richesses.
Or tout l’intérêt politique de cette « science » du bonheur, c’est d’être un outil d’individualisation et de « psychologisation » des problèmes politiques et économiques. On comprend alors mieux pourquoi cette « science » du bonheur produite par les psychologues et les économistes dominants est devenue un puissant instrument pour affaiblir chez le citoyen le sens du bien commun et de l’action collective.
Mais pour que le bonheur puisse devenir un instrument politique, il fallait le rendre objectif, mesurable et manipulable par le champ politique. C’est exactement ce que permet désormais le Big data : faire du bonheur « une affaire de statistiques de masse et des données personnelles [6]».
En effet, avec le développement d’Internet, des smartphones, des applications et des réseaux sociaux, on peut désormais collectionner une quantité gigantesque d’informations sur notre vie personnelle quotidienne, sur nos manières d’être, nos relations, nos émotions, etc.
Comment sont utilisées toutes ces données personnelles ?
Les grandes entreprises et institutions politiques les utilisent pour comprendre et modifier notre conception du bonheur, pour agir sur notre façon de voir le monde. Par exemple, Facebook en 2014, a révélé avoir fait une expérimentation sur 689 000 usagers, sans les en informer, dans le but d’agir sur « les affects et pensées des usagers ».[7] On comprend alors que le bonheur est devenu un enjeu vital pour les entreprises et les politiques (comprendre ce que ressentent les individus qui composent la société et influer sur les sentiments, réactions, manières d’évaluer), et est devenu un critère quantitatif pour mesurer le bien-être général. Le bonheur est ainsi ramené à une unité de rendement, lié au comportement consumériste, et cela lui donne une valeur monétaire. Autrement dit, le bonheur devient « un thermomètre affectif [8]» à usage politique et économique.
En tant qu’instrument politique, le discours actuel sur le bonheur est un puissant moyen de détourner l’énergie individuelle et sociale de la critique et de l’action collective au service de plus de justice et de bien commun. Telle est l’idée que nous proposons d’approfondir lors du prochain article de synthèse du livre Happycratie.
Notes :
[1] Edgar Cabanas & Eva Illouz (2018), Happycratie, éditions Premier Parallèle, p. 219-220
[2] Edgar Cabanas & Eva Illouz (2018), Happycratie, éditions Premier Parallèle, p.66-67
[3] Edgar Cabanas & Eva Illouz (2018), Happycratie, éditions Premier Parallèle, p.67
[4] Edgar Cabanas & Eva Illouz (2018), Happycratie, éditions Premier Parallèle, p.83
[5] Edgar Cabanas & Eva Illouz (2018), Happycratie, éditions Premier Parallèle, p.88
[6] Edgar Cabanas & Eva Illouz (2018), Happycratie, éditions Premier Parallèle, p.58
[7] Eva Illouz, Saving the Modern Soul, 2008, UC Press.
[8] Edgar Cabanas & Eva Illouz (2018), Happycratie, éditions Premier Parallèle, p.64