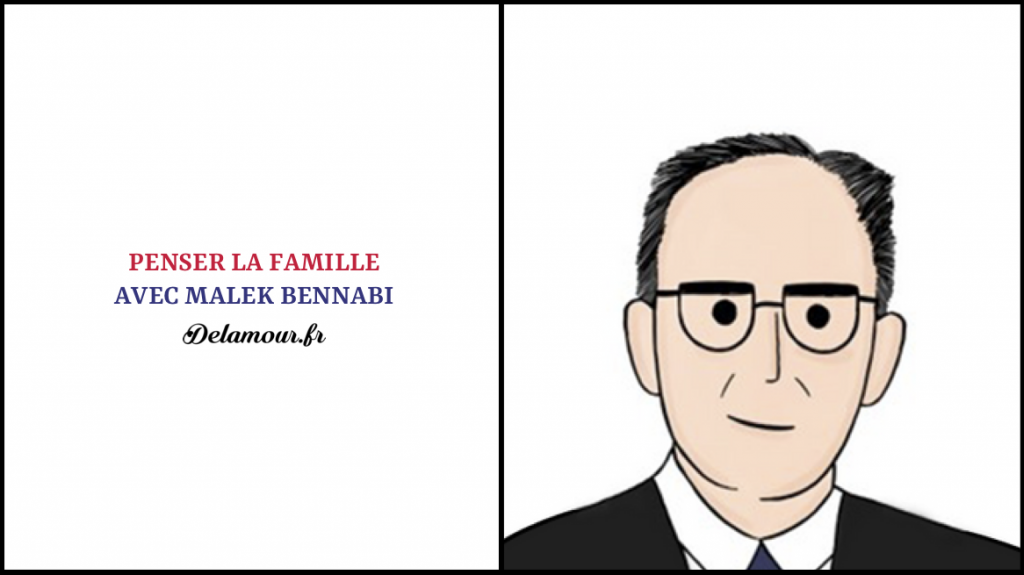
« Quelle est l’action la plus méritoire de votre vie, et à qui la devez-vous ? »[1]. Nous sommes vers 1930, à Paris, probablement vers le quartier latin, lorsqu’un groupe de jeunes étudiants s’est posé cette question pour mener une introspection. Malek Bennabi – penseur musulman de référence du 20e siècle –, fait partie du groupe. Il va enquêter sur ce qui lui a donné la force de faire la plus belle action de sa vie, et par-là, il nous ouvre une fenêtre sur deux questions : qu’est-ce qu’une famille ? Quelle est la valeur supérieure qui doit animer une personne : « développement personnel » ou bien commun ?
Bennabi raconte la famille musulmane
En s’interrogeant sur la question de savoir quelle est la plus belle action de sa vie et à qui il la doit, Bennabi plonge dans les souvenirs de son enfance. Il se souvient de la plus belle action qu’il ait réalisée dans sa vie, à l’âge de 6 ou 7 ans, alors qu’il vit à Constantine. Avant sa naissance, la générosité était une institution familiale forte, une qualité collective, une activité régulière et non pas simplement le geste d’individus qui donnaient quand ils avaient envie de donner.
« La niche, placée à côté de la porte de chaque maison et où les habitants mettaient à des heures déterminées le repas des pauvres pour leur éviter l’humiliation de la mendicité à haute voix aux portes des habitations, avait disparu avant ma naissance. L’usage de l’alcool apparut et commençait ses ravages. Les premiers abus de confiance contraires à des traditions immémoriales eurent lieu et firent disparaître ces traditions peu à peu. C’est ainsi que cette tradition de solidarité sociale qui consiste à prêter à une mariée tous les bijoux du voisinage disparut dès mon enfance. Elle disparut parce que les bijoux prêtés à un faux mariage n’avaient pas été rendus à leurs propriétaires ».[2]
Parmi les derniers témoins du passé qui l’entourent, il y a son oncle et sa femme chez qui il vit à Constantine. Son oncle meurt, sa femme n’a plus les moyens de le garder. Il part donc rejoindre ses parents à Tébessa. C’est là qu’il va faire connaissance avec sa grand-mère maternelle Hadja Zoulikha, qui lui raconte des histoires, lors des veillées d’hiver. Hadja Zoulikha va raconter un souvenir majeur de la vie de sa mère Hadja Baya, lorsque celle-ci a dû quitter Constantine. La plupart des grandes familles ont émigré en Tripolitaine ou ailleurs, car elles ne voulaient pas cohabiter avec le colon français, et surtout, car elles devaient sauver l’honneur de leurs jeunes filles en les préservant contre le viol :
« Pendant que les Français entraient par la Brèche, les jeunes constantinoises et leurs familles quittaient leur ville en utilisant des cordes qui cédaient parfois, précipitant les vierges dans l’abîmes. Mon aïeule, Hadja Baya, a vécu cette tragédie. Son père et sa mère, la poussant devant eux à travers les rues d’une ville en désarroi, la conduisirent au bord du précipice, comme Abraham avait conduit jadis son fils Ismaïl pour le sacrifice propitiatoire sur l’autel de Dieu. Cette fois, mon aïeule devait être immolée sur l’autel d’une patrie détruite pour sauver l’honneur d’une famille musulmane. Mon aïeule a échappé cependant à un sort terrible : la corde le long de laquelle elle s’était glissée n’avait pas cédé. Et, avec sa famille, elle était allée se réfugier à Tunis, puis la Mecque, avant son retour en Algérie quelques années après une fois mariée et ayant des enfants. Elle est morte, mais le souvenir de son épisode tragique que je viens de résumer lui a survécu ».[3]
Ainsi, l’enfant Malek grandit avec le récit tragique de sa famille qui doit fuir la colonisation pour sauver son honneur. Il voit bien, très tôt, que la colonisation n’a rien d’une entreprise positive visant à apporter la civilisation et qu’elle déclenche plutôt le chaos et l’humiliation générale. Et au milieu de ce chaos, il y a cette dame – son arrière-grand-mère – qui avait su faire preuve d’un haut sens de l’honneur.
« Donnez-moi la part de Dieu »
Cette histoire ainsi que d’autres que lui raconte sa grand-mère, vont donner à Bennabi la force de se tenir debout et droit dans sa vie :
« Ses contes, ses anecdotes pieuses sur la bonne action récompensée et la mauvaise châtiée, me façonnaient à mon insu. Par elles, j’ai appris que la charité est un thème favori de la morale islamique. Et c’est une de ses anecdotes sur la charité qui me valut un jour, à l’âge de six ou sept ans, l’action que je crois en effet la plus méritoire de ma vie ».[4]
On voit l’influence de son arrière-grand-mère, puis celle de sa grand-mère et maintenant celle de sa mère :
« Qu’on imagine, dans une famille pauvre, ou appauvrie (par la colonisation), où le père ne travaille pas, les enfants ne peuvent pas être nourris. Au demeurant, c’était ma mère qui, par un travail de couture, nourrissait la nichée. C’était aussi elle qui tenait les cordons de la bourse (…).
La bourse familiale était très plate (…). Mais ma mère était un intendant qui avait conscience de l’insuffisance du régime de la famille. Et pour compenser cette carence alimentaire pour ses enfants, elle faisait tous les vendredis un extra. Chaque vendredi à midi j’avais droit, avec mes deux sœurs, à une portion de cette gourmandise tébessienne qu’on appelle le “r’fiss”, faite de dattes pétries avec un peu d’huile dans de la galette écrasée. Ce jour-là à midi, j’avais donc eu ma ration de “r’fiss”. On devine avec quelle gourmandise l’enfant que j’étais écrasait sous ses dents la pâte délicieuse.
Soudain, à la porte de la maison, la voix d’un mendiant s’éleva : “Donnez-moi la part de Dieu… !” Et l’enfant qui n’avait mangé à peu près que la moitié de son mijot s’arrêta. Une histoire de sa grand-mère lui était revenue subitement à l’esprit. Et l’enfant alla porter sa ration au mendiant.
Un quart de siècle après, à Paris, l’homme qu’il était devenu comprit ce qu’il devait à une vielle femme. Et aujourd’hui, je dois noter dans ces Mémoires que dans cette période tragique où le pays n’était plus maître des leviers de son existence, et où les jeunes d’avant la première guerre mondiale n’avaient plus que le souci de s’installer le mieux possible dans l’ordre colonial, la vieille génération de mon grand-père et de ma grand-mère a conservé le capital historique essentiel, ces traditions et cette âme sans lesquels le pays ne pouvait plus refaire son histoire ».[5]
L’expérience familiale de Malek Bennabi est intéressante pour nous aujourd’hui parce qu’elle nous ouvre sur la vision islamique de ce qu’est la famille et de ce que doit être la valeur supérieure qui doit animer un individu.
Qu’est-ce qu’une famille ?
Tout petit, Malek n’est pas simplement l’enfant d’un couple – ceci est la définition moderne et individualiste de la famille, un couple et des enfants – mais de toute une communauté de personnes liées entre elles par les liens du sang, du mariage, du voisinage, de la fraternité et de la solidarité.
En plongeant dans sa biographie, on redécouvre que le mot « famille » a en réalité une signification et une réalité plus large (famille élargie) que ce qu’on entend aujourd’hui par « famille » (famille nucléaire). Toutes les personnes mariées ou célibataires, veuves, divorcées, mineures ou âgées sont incluses dans la famille : elles sont solidaires les unes des autres, et c’est en ce sens qu’elles font famille.
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant » dit un proverbe africain. Si, comme certains en rêvent, pour qu’un enfant « réussisse » à l’école, rejoigne les grandes écoles pour avoir un poste dans un grand groupe ou dans l’administration, il y a besoin de monter et d’animer tout un réseau social d’accompagnateurs, d’intervenants et de cadres d’entreprises…, former à la générosité et à la noblesse morale nécessite une énergie et un réseau au moins similaires. En effet, on a besoin de tout un village, de toute une famille élargie pour éduquer un enfant. Pour grandir, on a besoin de s’intégrer dans le courant de la vie – à l’image d’une voiture qui rejoint une autoroute où des voitures sont déjà là, à côté, derrière et devant soi –, on a besoin de s’intégrer dans un réseau social qui va nous apporter des idées, des expériences, des témoignages et des exemples qui vont façonner notre conscience, notre force morale, notre joie de vivre, notre sens pratique, etc.
Ce réseau social, c’est la famille au sens large : les grands-parents, les parents, les oncles et tantes, les cousins et cousines, les neveux et nièces, les voisins, les amis et les collègues de travail… C’est à travers les situations qu’on observe, les évènements qu’on vit ensemble, les histoires, les anecdotes, les proverbes ou chants qu’on nous transmet, qu’on forge sa force morale.
Un couple et les enfants ne suffisent pas pour faire famille et pour faire l’éducation morale de chacun. Car à défaut d’un village ou d’une famille élargie, le couple est condamné à éduquer l’enfant en le livrant aux tablettes numériques, aux industries de la consommation et du divertissement.
Raconter des histoires, c’est façonner l’avenir
Pour grandir, chacun a besoin de se connecter sur les plus vieux et sur les plus jeunes, c’est-à-dire « sur le passé avec ses derniers témoins, et sur l’avenir avec ses premiers artisans »[6]. La « famille » ici, c’est une ambiance sociale, un « plasma culturel » dans lequel la grand-mère – ainsi que d’autres personnes de la famille élargie – joue le rôle qu’occupent aujourd’hui Disney, Hollywood, Facebook… : celui de raconter des « stories », ou des histoires.
Raconter des histoires n’est pas un simple « divertissement » : ça façonne notre sensibilité, notre sentiment d’aimer ou de détester, nos préférences, notre façon de choisir, nos idées et nos valeurs, nos désirs et nos projets qui vont gouverner notre vie future. Raconter des histoires, c’est planter des graines d’idées et de valeurs qui vont donner des fruits demain, à travers nos projets ainsi que nos actes, individuels et collectifs. Raconter des histoires, c’est façonner l’avenir d’une génération.
Aujourd’hui, les industries de l’imaginaire, du divertissement et de la publicité, en racontant des histoires en série, façonnent notre imaginaire et colonisent notre vie future. Raconter des histoires, c’est offrir les moyens de résister au mal de son temps. Car les histoires offrent à chacun d’entre nous le pouvoir de comparer ce qui se passe ici et maintenant avec ce qui se passe ailleurs ou ce qui s’est passé avant par le passé. Ce travail comparatif permet de prendre de la distance et d’exercer son jugement critique sur ce qui se passe ici et maintenant.
Malek Bennabi doit l’essentiel de sa formation morale à ces trois femmes : son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère. Etre généreux, ça s’apprend. Il a fallu trois générations de femmes pour lui raconter toute une somme d’histoires, d’anecdotes et de chants et lui inspirer, par leur exemple, le sens de la générosité et plus largement, le sens de la noblesse qu’il démontrera dans le cours de sa vie, dans son engagement intellectuel et politique. Chargé de la mémoire de leurs histoires et de leur exemple, il trouve la force de refaire le geste d’Abraham : sacrifier ce qu’il a de plus précieux, donner ce qu’il aime le plus. Ici, l’enfant de 6 ou 7 ans qui vit dans le manque voire dans la pauvreté, accepte de donner sa part de r’fiss pour nourrir un mendiant. Il réalise là un grand acte que l’islam invite chacun à multiplier dans sa vie :
« Aucun de vous ne sera vraiment croyant tant qu’il n’aime pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même »[7].
Entre “Développement personnel” et bien commun, savoir choisir
Quelle valeur supérieure doit-on suivre : développement personnel ou sens du bien commun ? A-t-on suffisamment insisté pour que l’enfant garde à l’esprit que « L’essentiel, c’est que tu sois indépendant et épanoui dans ce que tu fais » ? Ou bien pour qu’il sache qu’« être un Homme, c’est se mettre au service des autres » ?
Bien entendu, on peut parfois combiner ces deux valeurs. Mais dans la vie réelle, il y a bien des situations concrètes qui obligent à choisir entre les deux. Entre venir étudier à Paris pour revenir en Algérie assurer sa carrière dans l’administration coloniale, ou servir le bien commun, c’est-à-dire résister à la colonisation et servir la dignité d’un peuple, Bennabi devait choisir. Entre manger à sa faim, déguster ce qu’il aimait le plus (le r’fiss) ou en faire don à quelqu’un qui était dans le besoin extrême, l’enfant Bennabi a fait son choix.
Aujourd’hui, le discours dominant (du cinéma, de la psychologie, de la publicité, et de la famille…) insiste beaucoup plus sur le « développement personnel » que sur le don de soi et le devoir de servir les autres. Or, une génération animée par le désir de donner et de se donner est capable de soulever des montagnes et de se libérer ; une génération animée par le désir d’épanouissement individuel avant tout est condamnée à dépendre d’une industrie qui la fait chanter au rythme de la consommation permanente.
Donner « la part de Dieu », c’est donner une part de ce qu’on a, une part de ce qu’on aime, une part de son bonheur pour aider quelqu’un qui en a davantage besoin que soi. C’est donner indépendamment de son intérêt ou de son épanouissement personnel.
En conclusion, si Bennabi est intéressant pour nous aujourd’hui, c’est parce qu’il nous rappelle qu’une famille est davantage qu’un couple : nous appartenons tous à la famille humaine et à la famille de toutes les personnes qui nous entourent. Une telle vision de la famille repose sur une valeur supérieure : l’interdépendance, la solidarité et le sens du bien commun sont des valeurs supérieures à l’indépendance et à l’épanouissement individuel.
Notes
[1] Bennabi, Malek (2006), Mémoires d’un témoin du siècle. 1905-1973. Alger, éditions Samar, p46
[2] Bennabi, Malek (2006), Mémoires d’un témoin du siècle. 1905-1973. Alger, éditions Samar, p46
[3] Bennabi, Malek (2006), Mémoires d’un témoin du siècle. 1905-1973. Alger, éditions Samar, p45
[4] Bennabi, Malek (2006), Mémoires d’un témoin du siècle. 1905-1973. Alger, éditions Samar, p47
[5] Bennabi, Malek (2006), Mémoires d’un témoin du siècle. 1905-1973. Alger, éditions Samar, p47-48
[6] Bennabi, Malek (2006), Mémoires d’un témoin du siècle. 1905-1973. Alger, éditions Samar, p45
[7] Hadîth rapporté par al-Bukhârî et Muslim
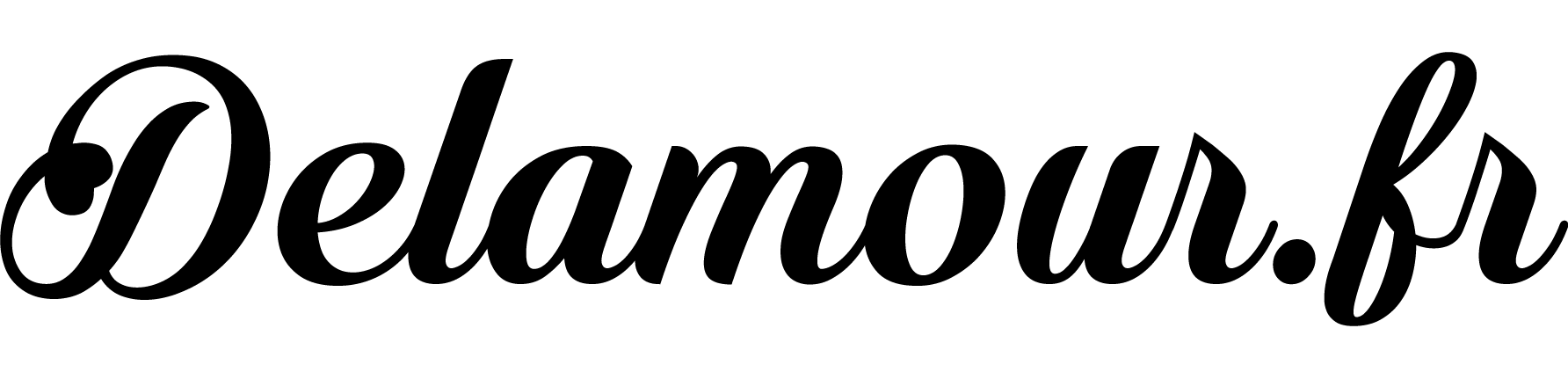

Merci pour ces écrits de Malek Bennabi, qui en nous touchant démontre la haute valeur de la transmission, qui ne semble pas être le seul fait de la “famille” au sens restreint du terme.
Un bémol cependant : sur l’opposition entre le service du bien commun et le “développement personnel” (je reprends vos guillemets), je ne vois absolument pas en quoi ils seraient incompatibles : qui soutiendrait que la dépendance aux nouvelles technologies (smartphones, réseaux sociaux, etc.) en constituerait un aspect, à part les transhumanistes ? Au contraire on observe l’existence d’une certaine mode à faire de l’humanitaire, des maraudes, etc. et on constate que cela contribue au bien-être de la personne : “la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit”. L’homme est un “animal social”, et un comportement foncièrement individualiste ne contribue pas au bien-être.
D’autre part, ne dit-on pas “charité bien ordonnée commence par soi-même” ? Pour contribuer au bien commun, il faut avoir de bonnes bases, légué dans le cas de Malek Bennabi par sa famille élargie. Ne peut-on pas dire que ce type de transmission constitue du “développement personnel” ? Il est vrai que cette dernière appellation n’a pas l’authenticité du témoignage que vous apportez.
Enfin, et pour rester dans les proverbes : “quand on aime on ne compte pas”. Ceci veut dire qu’on ne compte pas ce que l’on donne, mais aussi ce qu’on ne donne pas. On ne saurait reprocher à l’amant un manque d’amour à l’égard de l’aimé. Illustrons : quelqu’un ayant un caractère excessivement généreux, donnant tout aux autres et rien à soi-même, verra sa situation aggravée s’il suit les discours incitant à la libéralité, tels le vôtre. Au contraire de l’Homme avare, ne dépensant que pour lui, qui devra éviter les discours inverses incitant à l’égoïsme.
Il n’y a pas de “recette miracle” (bien que le miracle, constituant “l’exception”, “confirme la règle”, régissant la recette) : à chacun de trouver son tempo.
Alexandre, merci pour ces réflexions.
L’opposition entre “bien commun” et “développement personnel” n’est pas que théorique. Dans l’histoire de l’humanité, l’époque qui a prétendu faire du développement personnel (viser son bien-être, son épanouissement, son indépendance avant tout), tout en n’étant pas égoïste pour autant, c’est aussi l’époque où se généralisent le célibat, le divorce et les maisons de retraites. Donc au-delà de l’affirmation selon laquelle on peut réconcilier les deux, dans les faits, ceux qui prétendent réconcilier les deux sacrifient le sens du bien commun et donnent priorité à leur développement personnel.
Donner priorité à son développement personnel ne veut pas dire être égoïste. On peut se soucier de son développement personnel tout en pensant aux autres. Mais le souci des autres, le don de soi, la charité… n’est plus qu’un moyen comme un autre de développement personnel. Et ils deviennent “à la carte”, “indolores”, et “sans engagement” (Cf. Gilles Lipovetsky, Le crépuscule du devoir).
Ensuite, si tout est “développement personnel”, on ne peut plus rien distinguer et donc critiquer.
Enfin, lorsque tu appliques à Bennabi cette sagesse biblique – qui est juste – ça ne colle pas. Car Bennabi ne commence pas à s’appliquer la charité à lui-même : bien au contraire, il sacrifie son bien-être pour offrir à quelqu’un qui en a plus besoin que lui.
[…] est l’action la plus méritoire de votre vie, et à qui la devez-vous ? »[1]. Nous sommes vers 1930, à Paris, probablement vers le quartier latin, lorsqu’un groupe de […]